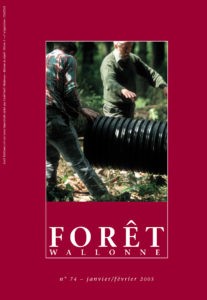L’auteur mène ici une réflexion sur le rôle positif, neutre ou négatif que pourrait jouer l’espèce cerf dans les programmes Natura 2000 ou autres. Plus largement, il s’interroge sur les réactions comportementales du cerf face à des perturbations parfois importantes de son milieu. Dans le cadre précis de la restauration d’une zone de tourbière en Hautes-Fagnes, l’aménagement risque de provoquer une désertion des animaux aux détriments des peuplements forestiers de production voisins ou, au contraire, va amener une concentration des cerfs sur le territoire en question et mettre ainsi en péril les efforts consentis pour restaurer l’équilibre naturel. Il conviendrait alors de prendre en considération un maximum d’éléments afin d’éventuellement introduire des mesures particulières de contrôle des populations.
Licoppe A.
Licoppe A. [2005]. Réflexion sur le rôle du cerf dans des programmes de conservation de la nature. Forêt Wallonne 74 : 32-37.