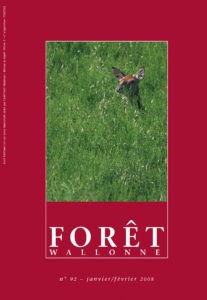Dans le contexte de forte expansion démographique du sanglier, les réserves posent un délicat problème de gestion. L’impact de ces zones refuges et l’influence des méthodes de gestion mises en place pour réduire cet « effet réserve » sont ici étudiés grâce au suivi télémétrique et GPS des animaux. Les résultats montrent qu’il n’existe pas de grandes migrations de sangliers et que le phénomène de « réserve » reste local. Ce qui ne va néanmoins pas sans poser une série de problèmes : en se concentrant ainsi dans la réserve le jour, les animaux se retrouvent en situation de sévère compétition alimentaire lors de la phase de nourrissage nocturne. Une redistribution des sangliers est alors observée la nuit venue autour de la réserve. Ces résultats révèlent donc une occupation de l’espace typique des sangliers autour d’une réserve. Pour limiter la concentration des animaux dans la zone de quiétude, des battues de décantonnement sont effectuées les veilles de jours de chasse. Le jour même, après l’action de décantonnement, 70 % des animaux se baugent à l’extérieur de la zone de battue. Cette proportion décroît ensuite jusqu’à 20-30 % au delà du huitième jour. Ces résultats montrent donc qu’il faut les répéter un certain nombre de fois au cours de la saison de chasse. L’efficacité des battues de décantonnement pour réduire cet effet réserve montre qu’il existe des solutions raisonnées pour résoudre cette problématique. Le juste équilibre entre l’absence totale de dérangement et la chasse intensive doit alors être trouvé afin d’éviter la surdensité de sangliers tout en préservant une relative quiétude sur le site.
Tolon V., Baubet E.
Tolon V., Baubet E. [2008]. L’effet des réserves sur l’occupation de l’espace du sanglier. Forêt Wallonne 92 : 15-25.