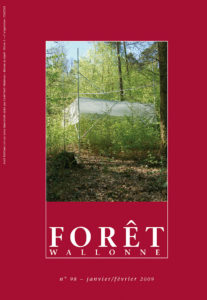Réaliser le bilan de fertilité d’une station s’inscrit dans la gestion durable de la forêt. Les écosystèmes forestiers les plus pauvres sont menacés par des déséquilibres nutritionnels sous l’effet des dépôts atmosphériques et des changements climatiques. De plus, la diversification des sources énergétiques, l’évolution des techniques d’exploitation du bois et de sa transformation conduisent à une exploitation accrue de l’arbre. Face à ces pressions le forestier doit pouvoir poser un diagnostic fiable sur l’état des sols de sa forêt. À partir d’un bilan de fertilité estimant les flux des éléments minéraux dans l’écosystème, le forestier pourra agir à son niveau pour maintenir tel ou tel type d’élément. Le choix de la sylviculture (structure de la canopée, densité du peuplement), de l’essence, du type d’exploitation (tronc ou houppier)… influence véritablement le bilan global. La nature et la quantité de produits exportés de la forêt affectent également considérablement les sorties totales d’éléments minéraux. Les concentrations en éléments suivant les compartiments de l’arbre augmentent dans l’ordre : bois du tronc, branche, feuillage.
Mathieu Jonard, Frédéric André, Quentin Ponette
Jonard M., André F., Ponette Q. [2009]. Cycle des éléments et évaluation de la fertilité chimique en forêt. Forêt Wallonne 98 : 60-70.