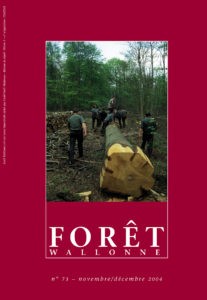Les ornithologues ont récemment constaté qu’une partie des oiseaux liés aux landes ou aux milieux buissonnants se maintenaient bien dans les coupes à blanc et les jeunes plantations, caractéristiques de la sylviculture traditionnelle des peuplements équiennes d’épicéa. Quelles sont ces espèces ? Quelles sont les caractéristiques de l’habitat recherché par celles-ci ? Comment peut-on orienter éventuellement la gestion forestière pour maintenir à long terme ces habitats ? Telles sont les questions auxquelles souhaite répondre cette étude. Un premier inventaire par points d’écoutes a clairement mis en évidence un groupe d’espèces caractéristiques des milieux ouverts forestiers. Fait remarquable, chacune de ces espèces figure à un titre ou l’autre sur la liste rouge des espèces menacée en Région wallonne (pipit des arbres, tourterelle des bois…). Se limitant à ce groupe, de nouveaux inventaires ont été réalisés afin de caractériser l’habitat recherché par ces oiseaux. Les valeurs de 10 variables descriptives de l’habitat ont été calculées pour chacun des points d’inventaire. Ces variables ont comme caractéristique de pouvoir être également calculées sur base de parcellaires futurs établis par différents scénarios d’aménagement. Sur base de ces variables, on a pu caractériser chacune de ces espèces. Ainsi, le pipit des arbres sélectionne les points situés dans les petits milieux ouverts, très jeunes, de préférence dans une zone riche en feuillus. Le traquet pâtre, au contraire, recherche des milieux ouverts les plus vastes possibles… Enfin, et tel était l’objectif final de l’étude, des scénarios sylvicoles ont été comparés afin de juger à long terme de la disponibilité de ces milieux et donc de la possibilité de voir ces espèces se maintenir sans problème au sein du massif concerné.
Paquet J.-Y., Vandevyvre X.
Paquet J.-Y., Vandevyvre X. [2004]. La gestion des milieux ouverts forestiers pour la biodiversité : le cas de l’avifaune en Ardenne . Forêt Wallonne 73 : 8-14.