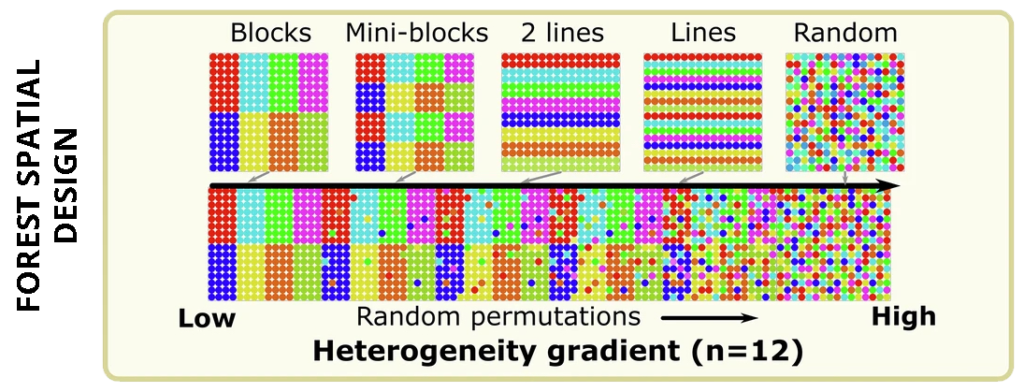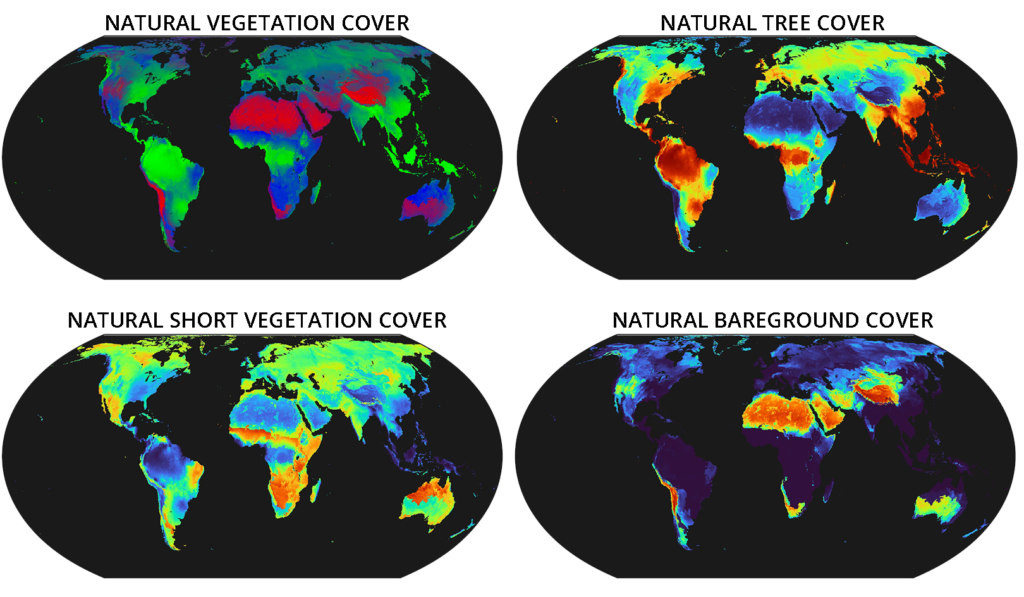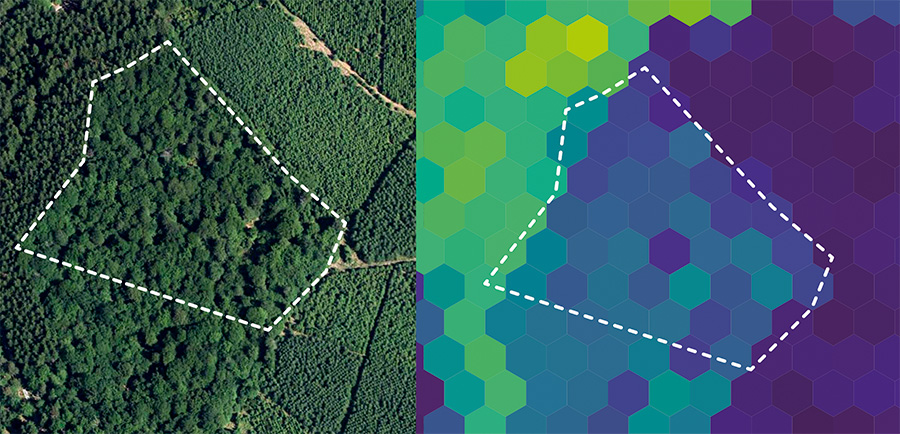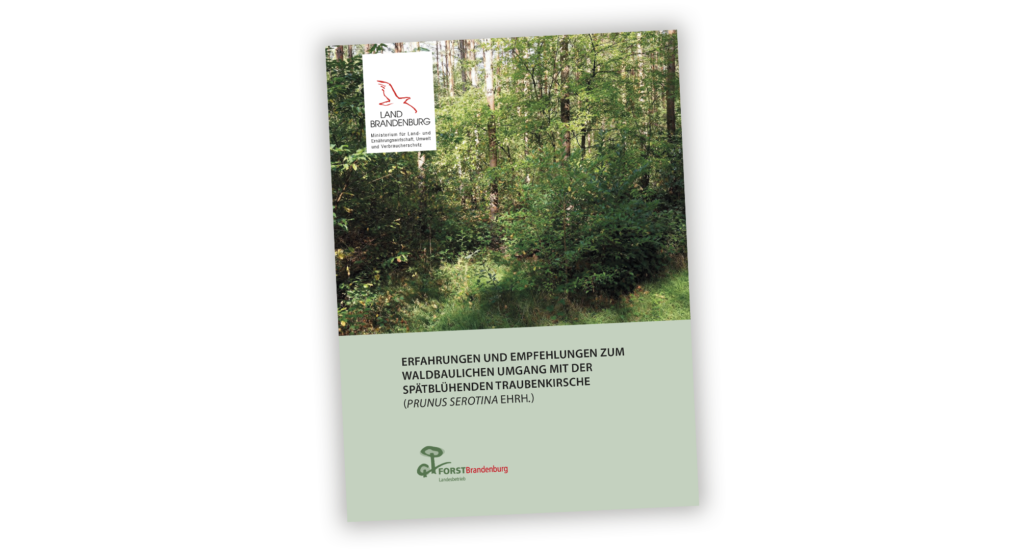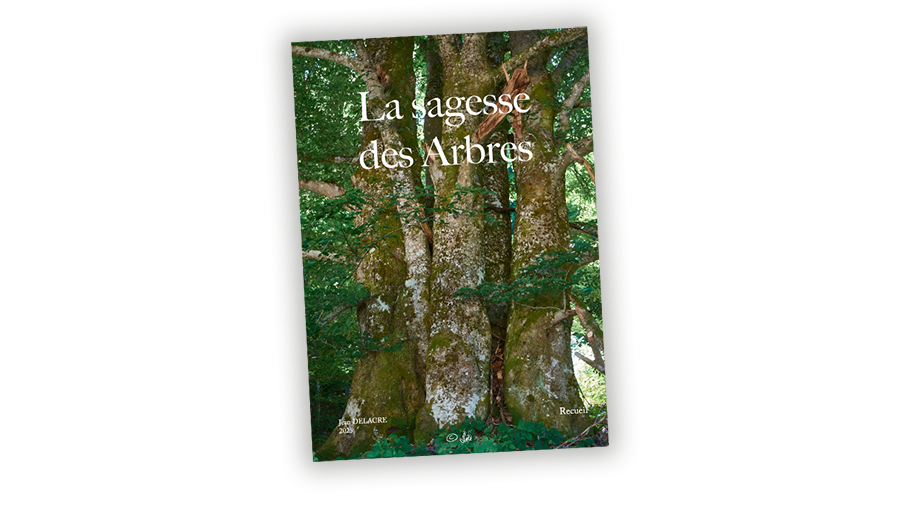Deux Instituts de recherche allemands ont étudié l’influence de différentes essences sur le bilan hydrique (transpiration, interception, etc.) et sur le cycle de l’eau (stockage de l’eau dans le sol, recharge des nappes phréatiques, etc.) dans le cadre d’un projet commun (InteW2). Six essences ont été étudiées : hêtre, épicéa, douglas, pin, chêne rouge d’Amérique et chêne pédonculé.
L’étude a montré que le chêne rouge d’Amérique et le pin sont particulièrement économes en eau du sol. Le chêne pédonculé et le douglas, par contre, évaporent davantage d’eau au cours de l’année.
Le douglas piège l’eau de pluie : une grande quantité d’eau est ainsi perdue car elle n’atteint pas le sol (« interception »). Néanmoins, le douglas utilise l’eau disponible de manière parcimonieuse. La recharge des eaux souterraines est donc globalement bonne et comparable à celle du pin.
Les nouveaux développements stratégiques (la Stratégie nationale pour l’eau et la Stratégie forestière 2050, en Allemagne) vont renforcer la collaboration entre les deux disciplines. Le projet InteW2 a réuni différents acteurs (experts de l’administration, de la foresterie, de la gestion de l’eau et de la société civile) afin de proposer un catalogue de bonnes pratiques et de recommandations pour les décideurs politiques.