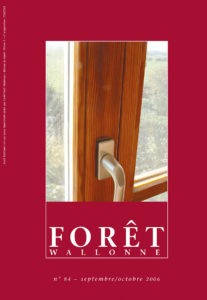En septembre dernier est paru le nouvel arrêté de subventions à la régénération à destination des propriétaires privés, en Région wallonne. Les nouveautés sont les suivantes : sortie des épicéas commun et de Sitka de la liste des essences subventionnées. Le but est de favoriser le douglas et les mélèzes, essences résineuses présentant un meilleur potentiel technologique ; adaptation à la régénération en futaie irrégulière : surfaces minimales plus petites, nombre de plants par hectare revu à la baisse également ; obligation pour le propriétaire d’être engagé dans une procédure de certification reconnue pour pouvoir bénéficier de subventions à la régénération des essences résineuses. Pour les essences feuillues, la mesure commencera en 2008 ; augmentation des montants alloués pour la régénération des chênes indigènes.
Heyninck C.
Heyninck C. [2006]. Subventions à la régénération : nouvel arrêté pour les forêts privées. Forêt Wallonne 84 : 55-57.